Il y a plus de 10 ans, durant deux années de résidence d’écriture à Mayotte, l’écrivaine mauricienne Nathacha Appanah observait la poudrière sur laquelle reposait le cent unième département français. Elle livre en août 2016 le récit d’une jeunesse insulaire au bord de l’explosion. L’opération Wuambushu initiée par le ministre de l’intérieur Gérald Darmanin en avril 2023 et toujours en cours à l’heure où nous écrivons, remet en lumière son roman. Publiées aux éditions Gallimard ce sont 183 pages qui bouleversent, sans toutefois contextualiser pleinement l’échec d’un système.
———————-
Bruce Wayne est mort à Gaza, à 17 ans. Tué d’une balle que Moïse estime n’avoir qu’à « peine tirée ». Et Marie la seule qui pouvait le croire est morte aussi.
———————-
Mayotte
Moïse brûle de ne connaître que les bribes de son histoire. Savoir d’où il vient le tenaille jusqu’à la fureur. Or Marie, sa mère adoptive, n’en savait pas tant. Puis les rues de Mayotte ne lui ont laissé ni le temps ni le choix. Alors à 15 ans Bruce sombre à mesure qu’il regrette ce que Marie a fait de lui. Un « muzungu noir » élevé dans une maison de blanc. Choyé entre des vacances et la clim, n’ayant jamais connu la misère. Tout ce qu’il incarne désormais il le récuse.
« Je voulais transpirer une sueur d’homme noir, je voulais manger du piment et du manioc […]. Je voulais appartenir à un endroit, connaître mes vrais parents, avoir des cousins, des tantes et des oncles. Je voulais parler une langue qui fait rouler les r et chuinter les s. », le shimaoré (p.64-65).
Quelle serait son existence si sa mère biologique, arrivée en kwasa sur une plage de Mayotte, ne l’avait pas abandonné ? Aurait-il été meilleur ou pire que ces autres enfants isolés ?
« Je pensais que le jour où je découvrirais la vérité sur ma naissance, quelque chose dans ma tête ferait bam. Que je tremblerais, que je me mettrais à réfléchir à toute vitesse, que toutes mes pensées se mettraient en bonne place comme un grand puzzle enfin résolu et que je deviendrais tout à coup un as de moi-même. Et qu’à partir de ce jour-là personne ne me la ferait plus, je saurais exactement qui je suis, ce que je vaux, ce dont je suis capable. Foutaises. », (p.61).
Moïse fugue et s’accroche à la Teigne. Mais le sobriquet de son jeune et nouvel acolyte présage un chaos que Bruce, leur chef, va rendre plus funeste encore. D’une balafre au meurtre Bruce mène Moïse au point de non retour.
——————
Gotham
Pour Bruce, les rues de Kaweni figurent autant Gotham City que Gaza. Elles sont le théâtre d’un capharnaüm où lui et d’autres jeunes sont emmurés. De désespoir en pis-aller ils s’accommodent comme ils peuvent du pire, même des chèvres. En « roi » de la pègre Bruce fait régner feux et émeutes, réserve les meilleurs joints, régente le moindre larcin. Survivre dans ces rues enrage chacun d’eux.
« Avant tout, il faut avoir de l’argent, de la thune, du fric, money money money, il faut que ça rentre, il faut que ça sorte, il faut que ça boive, que ça fume et que ça revende. », (Bruce p.100).
Et Moïse l’obsède. Bruce le hait autant qu’il redoute son œil vert. Il voit en lui ce qu’aucun enfant des rues ne pourrait espérer vivre à Mayotte.
« […] et j’ai pensé que t’étais le diable, que c’était le djinn qui t’avait envoyé avec ton œil vert […] et que je devais faire quelque chose pour que tu arrêtes de parler comme ça de parler de l’école, du collège, des pique-niques au lac Dziani, ton endroit préféré au monde […]. », invective-t-il (p.101).
Bruce devine à travers Moïse l’asymétrie cinglante de leur déchéance. Un envers qui le fascine et attise plus encore sa furie. Pour lui, Moïse est un affront ; le rappel amer de son indigence.
« J’ai su alors quel genre de gars t’étais. Le genre aveugle à la misère, qui va en vacances,[…], le genre qui n’a jamais connu la faim. », (p.70).
Il considère Moïse comme une menace pour son leadership, un second couteau à mettre au pas. Alors Bruce ne lui épargnera rien, pas même d’avoir à choisir son gang.
« Pas de pitié, Mo. Pas de pitié. T’es comme nous autres, Mo. T’es noir, t’es seul, t’es coincé ici, t’es à la rue. », menace-t-il (p.138).
—————–
La France
D’une prosopopée aux joutes oratoires de Bruce et Moïse, Appanah sonde une jeunesse mahoraise laissée pour compte. Elle dépeint une île au climat social si déplorable que s’y flingue la moindre utopie.
« [..], mais dans quel putain de monde tu vis ? C’est Mayotte ici et toi tu dis c’est la France. Va chier! La France c’est comme ça ? En France tu vois des enfants traîner du matin au soir comme ça, toi ? [..] En France les gens chient et jettent leurs ordures dans les ravines comme ça ? », vocifère Bruce contre Moïse. (p.101).
Mayotte, un éden à ce point infernal qu’on ne saurait brandir autre chose qu’une réalité cauchemardesque. Où les idéaux sont foutus d’avance. Sur cette jeunesse plane en effet une pesanteur, un sentiment de bombe à retardement. Même le plus utopiste des lecteurs décèle en elle un horodateur désolant. C’est une jeunesse désenchantée à une étincelle de l’embrassement total et d’une guerre urbaine.
Quant aux narrateurs métropolitains (Marie, Olivier et Stéphane), ils ont un regard plus blasé qu’à leur arrivée sur l’île. Ils sont désabusés mais leur amertume est teintée de condescendance et se drape dans un reliquat de colonialisme. Les trois protagonistes sont en effet les seuls qu’Appanah investit d’une mission (infirmière, policier et travailleur social). Et au fil du temps, à tant être « fracassés » par les drames qu’ils vivent sur cet espace insulaire leur mansuétude ne tient pas. Leur ressentiment décuple et vrille en un racisme sournois.
« J’ai trente et un ans et Cham m’a quittée. Il a déjà une autre femme, une Comorienne qu’il a rencontrée je ne sais où. La pute. Elle s’habille avec des vêtements colorés que j’appelle des costumes de clown, elle porte le masque de santal sur le visage et ça lui fait un visage de clown. C’est une pute de clown. Elle a des fesses rebondies, une peau jeune et noire. Tu veux du noir maintenant ? […] C’est bien de baiser des nègres ? » (Marie p.18-19)
En outre, ce sont les seuls adultes. Et les seuls à tenir une position socialement privilégiée. Ils sont blancs et l’absence d’un personnage principal mahorais de même envergure souligne la part d’exotisme et de clichés que draine le roman. Cette hiérarchisation se lit aussi dans la représentation que les personnages, y compris Moïse, se font du comorien/mahorais.
« je voulais des tam-tams et des cris » (Moïse p.65)
Et, tout au long du roman, Appanah désigne les trois protagonistes occidentaux par leur véritable patronyme. Les deux jeunes autochtones sont, eux, affublés d’un nom d’emprunt biblique et de super-héros d’une BD américaine (Moïse, Bruce Wayne). Un lecteur alerte ne peut que lier cela à une des séquelles de l’impérialisme : la volonté insidieuse ou inconsciente d’effacement et d’assimilation identitaire. Cette acculturation aurait presque pu passer inaperçue. Mais la symbolique prophétique et de surhomme introduite par Appanah crée un judicieux effet de lecture. Il accentue la tension narrative de l’intrigue et ironise sa tragédie. Un ressort d’autant moins anodin que le roman a en décor un désastre social indissociable du contexte historique et colonial de Mayotte. Même si l’écrivaine s’attache à le lier au seul versant migratoire.
Appanah dressera donc sans surprise l’image d’une île de cocagne où se ruent des vagues humaines venues d’ailleurs.
« je me demande combien d’entre eux, à droite ou à gauche, sont arrivés en kwassa. » (Marie p.15)
Des hommes et des femmes que l’autrice choisit d’invisibiliser en des termes impersonnels et dépréciatifs. Elle les anonymise voire les déshumanise comme pour mieux souligner leur statut de sans-papiers, l’illégitimité de leur présence.
« Ces gens-là » ; « l’autre foule bigarrée » ; « plusieurs femmes très enceintes » ; « deux groupes » ; « Une centaine de noirs » ; « la Teigne ».
Cette dépersonnalisation lui permet d’éluder une situation migratoire propre à Mayotte sans avoir à la contextualiser. Elle repose sa diégèse sur un knock-out social, brandit le spectre d’une horde qui menace et gâche une France idyllique. Elle dresse l’image d’un eldorado qu’une somme humaine gangrène : des « clandestins » comoriens responsables à la fois de l’infortune des personnages et du drame mahorais. Une rhétorique officielle diffuse et insidieuse que l’écrivaine reprend sans réussir à s’en dépêtrer.
———————-
Primé plusieurs fois, adapté au cinéma et au théâtre, sorti en bande-dessinée voire décrié dans le Muzdalifa House Tropique de la violence déconcerte d’un extrême à l’autre. Appanah introduit le lecteur assez banalement dans le récit. Puis le rythme métronomique des virgules, des interrogations, des répétitions et la frénésie des mots posent le lecteur au plus prés des névroses des personnages. Un delirium cadencé et vif que l’oralité de la narration intensifie. Nathacha Appanah égrène le temps, le lie à une rage, une détresse, des peurs et à la violence d’une mort qui fauche soudainement. C’est beau et haletant à la fois. Elle dépeint toutefois une réalité si mal mise en perspective que le lecteur saisit à peine que Mayotte est la quatrième île d’un archipel. L’écrivaine oppose des individus appartenant à un même espace. Un parti pris qui efface et disqualifie une Histoire commune avec le reste des Comores. Qui tait surtout les causes d’une problématique protéiforme à la faveur d’ une vision convenue, aux relents à minima stéréotypés. On appréciera tout de même une écriture polyphonique sans détours ni artifices qui file le compte à rebours d’une tragédie. C’est lire avec effroi le dégoût d’une jeunesse reléguée dans les tartisses du monde. Une grenade déclipsée que rien ne saurait désormais contenir.
« Tu entends ce bruit, on dirait le roulement des barriques vides, on dirait le tonnerre en janvier mais tu te trompes si tu crois que c’est ça. [..] Écoute le bruit de mon pays qui gronde, écoute la colère de Gaza , écoute comment elle rampe et rappe jusqu’à nous, tu entends cette musique nigga, tu sens la braise contre ton visage balafré ? [..] Ils viennent pour toi. », (p171-172).
Rafion Abouharia.
Photo: lemonde.fr
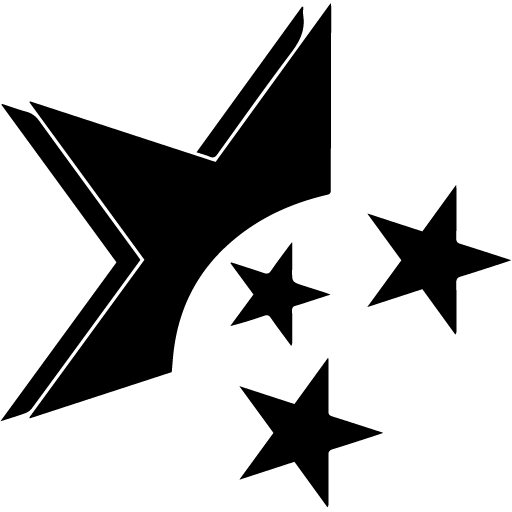

Very good https://is.gd/N1ikS2
Good https://is.gd/N1ikS2
Very good https://is.gd/N1ikS2
Awesome https://is.gd/N1ikS2
Good https://is.gd/N1ikS2
Very good https://is.gd/N1ikS2
Good https://is.gd/N1ikS2
Awesome https://is.gd/N1ikS2
Good https://is.gd/N1ikS2
uhezaf
j3ttem
ef4rpq
9nejqb
Super https://shorturl.fm/6539m
Very good partnership https://shorturl.fm/68Y8V
Super https://shorturl.fm/6539m
Good partner program https://shorturl.fm/N6nl1
Good partner program https://shorturl.fm/m8ueY
Cool partnership https://shorturl.fm/FIJkD
Top https://shorturl.fm/YvSxU
https://shorturl.fm/j3kEj
https://shorturl.fm/j3kEj
https://shorturl.fm/6539m
https://shorturl.fm/a0B2m
https://shorturl.fm/5JO3e
https://shorturl.fm/5JO3e
https://shorturl.fm/YvSxU
https://shorturl.fm/bODKa
https://shorturl.fm/j3kEj
https://shorturl.fm/TbTre
https://shorturl.fm/9fnIC
https://shorturl.fm/FIJkD
https://shorturl.fm/bODKa
https://shorturl.fm/oYjg5
https://shorturl.fm/5JO3e
https://shorturl.fm/oYjg5
https://shorturl.fm/VeYJe
https://shorturl.fm/I3T8M
https://shorturl.fm/Xect5
https://shorturl.fm/47rLb
https://shorturl.fm/VeYJe
https://shorturl.fm/MVjF1
https://shorturl.fm/fSv4z
https://shorturl.fm/MVjF1
https://shorturl.fm/LdPUr
https://shorturl.fm/PFOiP
jt9w1q
q3t7cu
lqrw4y
6l9vll
vjfpr1
otunsx
6fmw3w
tbcqfn
qe36dt
oagiud
kvqyv2
god77v